
 |
RUE DE LILLE
A travers l'histoire
La rue de Lille est un tronçon de la route qui va de Lille à Gand.
Depuis le rond-point du Cheval Blanc, jusqu'à la Becque de la
Viscourt,frontière entre Roncq et Halluin, elle traverse notre commune du
Sud au
Nord sur une longueur de 5,200 kilomètres environ.
Au fil du temps, elle s'est appelée : « Pavé de Lille à Menin, route
Royale, Impériale ou Nationale ». Selon les régimes en place.
La rue de Lille serait plus récente que la rue du Dronckaert sur
son
tronçon Croix-Blanche Halluin écrit M. le professeur Pierre Leman,
directeur des Antiquités du Nord - Pas-de-Calais dans son article
paru en
1988 dans le livret édité par la direction des Affaires culturelles
de
Marcq-en-Baroul : « La route de Menin ». D'après des plans anciens,
note-t-il, la rue de Lille coupe les parcelles de terrain, tandis
que dans
la rue du Dronckaert les parcelles sont perpendiculaires au chemin.
Ce qui
prouve son ancienneté. »

Malgré cela, la route serait plus que millénaire et pavée dès le
Moyen Age,
rien d'étonnant qu'elle fut autant fréquentée au cours de siècles,
aussi
bien par des princes que par des roturiers.
Les commerçants de Gand et de Bruges l'empruntaient pour venir à
la Foire
de Lille vendre leurs draps vers 1100.
Les pèlerins qui partaient pour Compostelle venant des Pays-Bas
et des
Flandres l'empruntaient également pour se diriger ensuite vers Paris.
Le trajet par voie d'eau sur la Lys et la Deûle était plus agréable
mais
plus long. Dans son histoire d'Halluin, l'abbé Coulon raconte que
Thomas
Becket plus connu sous le vocable de Saint-Thomas de Cantorbery
(archevêque
de cette ville) passa par la rue de Lille. Fuyant la persécution
d'Henri II, roi d'Angleterre, il se réfugia en France et habita un moment
à Lille.
C'est en 1170 qu'il vint à Halluin, baptiser le fils de son ami
Raynaud de Lampernesse. Cet enfant fut appelé Thomas, il vivait encore en 1224.
Devant la menace d'être excommunié, le Roi d'Angleterre fit revenir
Thomas à Canborbery, où il fut assassiné le 29 décembre 1170. En 1395,
le duc de
Bourgogne, Philippe le Hardi, venant prendre possession du comté
des
Flandres, au nom de sa femme Marguerite, ordonne aux échevins des
villages
traversés par la route Royale, de la faire réparer chaque année
:
« Car dit-il, le grand
chemin n'a été refait, il est fort empirez et enfondrez, bientot l'on ne porra aucunement aler à charroi et à
paines, à
cheval en yoer et l'on ne pourra mener les denrées et marchandises
de l'une des villes à l'autre » (français de l'époque). Malheureusement,
cette belle
route servit aussi à de nombreux passages de troupes, qui s'accompagnent
presque toujours de pillages, rançons, incendies, etc.
Il y eut l'armée de Philippe Auguste, les Français de Louis
X le Hutin qui
envahirent le comté en 1315, les Gueux dit Hurlus en 1582 venant
de Menin
et dévastant toute la région, Louis XIV et ses troupes lors de la
guerre de
Succession d'Espagne, le Prince d'Orange venant assiéger Lille,
les
Français s'opposant aux Autrichiens en 1793, la Grande armée de
Napoléon en
1803, les Cosaques en 1814, Louis XVIII fuyant Paris en 1815 avec
ses
Mousquetaires. Et plus près de nous l'armée de Guillaume II en 1914
et la
Wehrmacht en 1940.
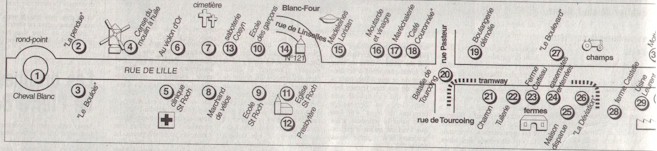
Heureusement, ce n'était pas toujours de tristes cortèges qui empruntèrent
la rue de Lille. A la mort de son père Philippe II d'Espagne, l'infante
Isabelle hérita du comté de Flandre. Accompagnée de son mari Albert
d'Autriche, elle entreprit de faire le tour de ses états. Venant
de Courtray, les archiducs arrivèrent à Halluin le 5 février vers midi,
dans
un beau carrosse attelé de six chevaux blancs. Tous les seigneurs
et
gentilhommes des environs étaient convoqués à Halluin pour les recevoir.
Les archiducs partirent ensuite vers Lille, en passant par Roncq.
Tout au
long de la route, les paysans acclamaient les souverains et tiraient
des
coups d'arquebuses.
Vingt-cinq ans plus tard en 1625, Isabelle repassa plusieurs fois
rue de Lille pour aller aux Pays-Bas dont elle était devenue gouvernante
générale
après la mort de son mari.
Quand, après la guerre du succession d'Espagne, Louis XIV
eut récupéré les
Flandres et les Pays-Bas, il résolut de faire lui aussi un grand
périple dans ses nouveaux états.
Il partit de Saint-Germain-en-Laye le 28 avril 1670 avec toute sa
cour. Le
Roi se rendit à Tournai, à Audenaerde et de là à Courtrai où il
arrivera le
21 mai. Le lendemain, il se dirigea vers Menin, et arriva vers 10
h à
Halluin pour « disner » vers midi. Il repartit ensuite vers Lille
en
passant par Roncq.
Toute la chaussée de Menin à Lille, c'est-à-dire quatre lieues (16
km)
était bordée d'une foule de paysans que les baillis avaient convoqués
pour
crier « Vive le Roy » tout le long de la route jusqu'à Lille où
le
souverain arriva vers 6 h du soir.
Louis XIV était accompagné de la Reine, de Monseigneur le Dauphin,
de
Madame, etc., et aussi Mlle de Montpensier et du ministre Louvois.
Le cortège du Roi et sa suite comportaient au moins 300 carrosses
et 3.200
chevaux.
Sans le faste du roi Soleil, le « Journal de Roubaix » du 8 août
1928
relate en ces termes le passage du prince Edouard, héritier du trône
d'Angleterre.
« Durant toute la matinée
d'hier, de nombreuses autos transportant vers
Ypres de nombreux légionnaires britanniques, ont traversé la commune.
Vers
9 h, on signale le passage du général Weygand qu'accompagnent le
général
Goura et le gouverneur de Paris, ainsi que le maréchal Pétain. Le
convoi du
Prince arriva vers 10 h. Il se composait de six voitures, son Altesse
occupait la deuxième.
![]()
Bon nombre de curieux stationnaient sur les trottoirs de la rue
de Lille.
En certains endroits, des gendarmes étaient postés.
Sans bruit, mais reconnus par des Roncquois, c'est Hitler et
Goering qui
passèrent par notre rue deLille vers 1940. Quelques jours après,
l'occupation allemande de Roncq le 28 mai 1940, des habitants
de la «nouvelle rangée » à la Déviation (rue de Lille) se trouvaient devant
leur
maison. Entre autres Charles Flament et Raoul Coisne. Venant de
la
direction de Lille, ils virent arriver des matos aux conducteurs
armés
précédant des véhicules découverts avec passagers, d'autres avec
des
mitrailleuses.
« Regardez, dit Raoul,
désignant une voiture, c'est Goering. » Et Charles
reconnut Hitler assis près du chauffeur dans une voiture avec des
passagers
à l'arrière. On sait aujourd'hui qu'Hitler vint visiter les
1 et 26 juin 1940, était-ce un pèlerinage ? Les endroits
où il avait séjourné en 1914-1918. En Belgique à Kruiseeche alors
hameau de
Comines où il connut le baptême du feu en 1914, Messines, Wijtsmchaete,
il
fut blessé dans cette dernière, et en France à la Montagne de Wervicq
où il
fut gazé dans la nuit du 13 au 14 octobre 1918 par des obus à gaz,
tirés
par les Anglais. Il resta aveugle cinq jours et en parle dans son
livre «Mein Kampf ». Il passe la nuit du 1er au
2 juin 1940 à
Annapes (F). M. Henri Bourgeois, président de la Société d'histoire
de
Comines - Warneton, a fait une étude très détaillée de ces journées.
En mai 1940, c'est une immense foule d'inconnus que la rue de Lille
vit
passer. Réfugiés quittant la Belgique envahie, à pied, en vélo,
en voiture,
ils se bousculaient sur la route
.
Un peu plus tard, en juin, ce sont les prisonniers français et anglais,
en
colonnes par quatre se dirigeant vers l'Allemagne à pied. Ils avaient
pour
la plupart étaient faits prisonniers dans la poche de Dunkerque
autour
deLille ou dans les Flandres. On en vit passer dans les deux sens.
Dès qu'une de ces colonnes était annoncée, des Roncquoise partaient
en vélo en direction de Lille, afin de voir si l'un des leurs était parmi
les
prisonniers, afin de leur glisser quelques douceurs et pour quelques
uns
d'entre eux, de quoi soigner leurs pieds douloureux après
de longues
marches.
![]()
Julien Olieux est quelque part sur la photo
Mais, n'oublions pas de rappeler pour ceux qui ont
connu cette période, la
triomphale arrivée à Roncq en septembre 1944 de l'armée des Alliés
;
Anglais, Canadiens, Américains venus nous libérer, accueillis à
bras
ouverts, on leur jetait des fleurs, les jeunes filles s'asseyaient
sur les
chenillettes et le capot des voitures à l'arrêt, on les embrassait
et on
leur offrait à boire. Ceux qui vécurent ces instants ne peuvent
l'oublier.



Revenons un peu en arrière. Au temps des diligences, il en partait
une de
Lille tous les jours pour Gand et Bruxelles passant par La Madeleine,
Marcq-en-Baroul, Bondues, Roncq, Halluin, Menin, Courtray, Gand,
puis
Bruxelles. Là il y avait une correspondance pour Liège et l'Allemagne.
Le
départ était en été à 6 h et 6 h 1/2 l'hiver. Ces diligences s'arrêtaient
à
diverses auberges dont « La tête d'or » à Roncq, afin de déposer
ou prendre
des voyageurs ainsi que des marchandises et changer de chevaux (l'abreuvoir
y était encore visible il y a quelques années).
Autrefois, bien avant la Révolution, toutes les routes royales,
impériales,
nationales ou départementales étaient plantées d'arbres des deux
côtés.
C'était « le bois des pauvres ». Ceux-ci avaient le droit de ramasser
les
petites branches tombées et quand on élaguait, les grosses branches
leur
étaient distribuées par le bureau de Bienfaisance. Au début d'avril
1918,
presque tous les arbres bordant les routes roncquoises furent brisés
ou
déracinés par plusieurs ouragans. Tous ces arbres furent débités
et vendus
au plus offrant. Le produit des ventes fut affecté au remplacement
des
arbres manquants. L'histoire ne dit pas avec quoi se chauffèrent
les
pauvres en attendant que les arbres repoussent.
Trois courses cyclistes auraient emprunté la rue de Lille : l'une
le 17
avril 1910, Paris - Menin ; la seconde, le Tour de France en 1946
ou 47, ce
jour-là les ouvriers et ouvrières de chez Motte (Actival) eurent
la
permission de quitter leur travail 1/2 heure pour regarder passer
la
course? Quand à la troisième, c'est beaucoup moins précis. Ce serait
le
circuit des trois villes rouges (départ d'Halluin) dont la date
est
toutefois inconnue. L'un ou l'autre de nos lecteurs et lectrices
aurait-il
entendu parler des trois courses ou peut-être y assisté, nous serions
heureux si l'on voulait bien nous contacter. Références :
- Livret « La route de Menin » édité en 1988 par la direction des
Affaires
culturelles de Marcq-en-Baroul.
- Histoire de Roncq de l'abbé Coulon.
- Histoire d'Haluin de l'abbé Coulon.
- Archives du « Journal de Roubaix ».
- Souvenirs personnels de Roncquois.
Dans le prochain épisode, rendez-vous au rond-point du Cheval-Blanc
pour
une promenade de 5,200 kilomètres.
Nous voici donc au rond-point du Cheval Blanc C'est là que
se situe la résidence du même nom dont nous avons déjà parlé ultérieurement.
Avançons un peu. C'est à notre gauche que se trouve le point culminant
de
Roncq (54 mètres, carte ING), au lieu-dit « La Pendue » ou « Les
Pendues » selon les cartes. Nos ancêtres y avaient établi deux moulins,
l'un à blé, l'autre à huile. C'est peut-être ce dernier qui était
appelé
sur une carte d'état-major : « moulin désolé », mauvaise interprétation
de
« moulin des olieux » (moulin des huiliers). L'un des deux existait
déjà en
1610, on peut le voir sur la planche 62 représentant Bondues-La
Croix
Blanche, d'un des albums de Croy, dessiné en 1610 par Adrien de
Montigny
sur l'ordre du Duc de Croy, seigneur de Roncq et environs.
Plus proche de nous, c'est sur cette même hauteur qu'en 1939, la
213 batterie de D.C.A. du 410R.A. édifiera une plate
forme surélevée afin de surveiller les environs jusqu'au Mont Kemel.
Quatre
canons de Défense Contre Avion étaient déjà installés dans le pré
entre la
plate forme et la rue de Lille.
De l'autre côté de la route, toujours en 1939, au lieu-dit « Le
Boulois »,
il y avait quelques petites maisons L'une d'elle était un café
« Au Chanteclair » tenu par M. et Mme Courtois, où les
soldats
pouvaient se divertir en dansant au son d'un orchestre formé par
les
enfants de la maison. On y servait du poulet-frites, car les tenanciers
faisaient l'élevage de ces volailles.
Les soldats n'avaient pas loin à aller, un sentier longeant la batterie
aboutissant en face cu café. Les soldats anglais du château d'Hespel
à
Bondues y venaient aussi.
Le lieu-dit « La Pendue » était connu sous le nom de « quartier
à puches ».
Puche est un mot patois désignant soit un puits soit une puce. Il
est à
supposer que le quartier ne comptait pas plus de puits qu'ailleurs
dans la
commune qui en possédait plus de 600, il faudrait plutôt penser
aux puces,
car au nº9 habitait un marchand de chiffons, résidence
idéale pour
ces bestioles.
Toujours à gauche, au nº21, se trouvait la ferme Destombes , dite « cense du moulin à huile » ou « ferme de la Rousselle ». De quand date cette ferme&fine;? Il est impossible de le dire. Bien que sur l'imposte la date de 1799 était gravée, la cense est plus ancienne. En effet, dans leur plaquette « Ceux de la Rousselle » Narcisse et André Destombes ayant fait des recherches sur la famille nous disent que la ferme de la Rousselle s'appelait déjà « cense Destombes » bien avait 1789 et était occupée par cette famille depuis plusieurs générations. On retrouve Hippolyte, Marie-Antoinette, Toussaint, Louis installés dans la ferme avant 1754. Un de leur descendants Jean-Baptiste, qui fut maire de Roncq de 1800 à 1803, y vit le jour en 1760. Il exerçait le métier de cultivateur et marchand huilier. En 1802 il obtient du premier Consul l'autorisation de rétablir le culte catholique à Roncq. La ferme comportait un étage qui a été démoli pour raison de vétusté. En même temps disparaissait un souvenir.
C'est en effet dans la grande salle qui s'y trouvait, qu'un prêtre
réfractaire, l'abbé Brédart, déguisé en marchand de bestiaux, célébrait
la
messe de cachette au péril de sa vie et de celle des fermiers pendant
la
Révolution. Un jour, sur le point d'être surpris, il s'habilla en
hâte,
sauta par la fenêtre et s'enfuit en direction de Linselles.
Quand le moulin fut démoli, les ailes furent utilisées comme plafond
pour
la bergerie. Sur l'imposte en plus de la date 1799, on pouvait voir
un
petit moulin sculpté, en bois.
Jean-Baptiste avait épousé Aimable Catteau le 14 octobre 1783 dont
les
parents exploitaient le manoir de Créquillon appartenant au comte
des
Wazières, dernier seigneur de Roncq.
Jean-Baptiste décède à Roncq en 1818.
Son fils Jean-Baptiste lui succède. Il épousa Catherine Vandebeulque
en
1823, et n'auront qu'une fille Florine qui convola plus tard avec
un autre
Jean-Baptiste Destombes son cousin. C'est ce ménage qui exploitera
« La
Rousselle ». C'est toujours un Jean-Baptiste qui sera propriétaire
en 1860
avec son épouse Sidonie Soenen. Leurs fils Jules né en 1908 est
le dernier
exploitant avec son épouse Léontine Vanbelleghem. Ils eurent un
fils Guy né
en 1940.
Beaucoup d'anciens Roncquois ont connu Jules. Quand son épouse décéda
en
1983, il continua seul à exploiter sa ferme.
Le 2 mars 1988, le feu prit dans les combles. Jules ne voulait pas
quitter
sa ferme. Il dut pourtant le faire en février 1992, devant entrer
à
l'hôpital de Tourcoing, où il décéda 15 jours plus tard.
La ferme Destombes fut réhabilitée par une association culturelle
propriétaire des lieux à cette époque.
En face de la ferme, a peu près à l'emplacement de la clinique Saint-Roch,
le Sieur Louis Capelle, fabricant de toile, demande l'autorisation
d'établir à cet endroit une briqueterie temporaire sur son terrain
en 1854.
De même, mais l'endroit exact n'est pas précisé, le Sieur Charles
Louis
Bostyn voudrait établir une fabrique de chicorée à la Rousselle
en 1859.
Durant ses campagnes, le duc de Marlborough séjourna à la ferme
de la
Rousselle, lors du siège de Lille, en 1708.
En 1814, à la fin de l'Empire, les Cosaques installèrent
leurs campements
dans les environs. A droite de la clinique Saint-Roch qui vient
récemment de fermer la section maternité fut, bâtie en 1981 en remplacement
de la clinique et maternité de Linselles. Plus tard une aile fut
ajoutée
pour accueillir les convalescents.
A gauche, au 41, se trouvait un café : « Au Violon d'Or » tenu
par Henri Wattrelos plus connu sous le nom de Terlos. Il faisait
partie de
l'harmonie du Blanc Four et aimait animer son quartier. Au mois
d'août
1931, il voulut organiser un spectacle qui attirerait du monde :
faire
envoler un ballon. Le grand jour arrivé, il y avait foule dans la
pâture où
l'engin était arrimé. Henri monte dans la nacelle avec sa fille.
Il tient à
la main deux sacs : l'un contient son meilleur pigeon qu'il veut
lâcher
très loin du Blanc-Four, et dans l'autre sac il a placé une bonne
bouteille
de Genièvre qu'il espère boire là-haut.
L'harmonie entonne la Marseillaise tandis que le pilote lâche du
lest. Pas
suffisamment car le ballon part à l'horizontale et fonce sur les
musiciens qui n'ont que le temps de se mettre à l'abri. On allège encore le
ballon
qui, cette fois, s'élève tandis qu'Henri salue la foule avec son
képi.
Mais est-ce la peur&fine;? L'émotion du départ? ou
les prunes du
jardin mangées le matin&fine;? Arrivé au-dessus de La Madeleine,
Terlos fut
pris d'un besoin urgent et le ballon dut atterrir en catastrophe.
Henri et
sa fille sont rentrés en train. Prévenue, on ne sait pas comment,
l'harmonie alla les attendre à la gare du Pied de Bouf pour leur
donner une
aubade (d'après un article paru dans Nord Eclair en 1979).
Toujours du même côté, se trouve le cimetière du Blanc Four qui
date de 1873. C'est là qu'est inhumé Alphonse Loul, ancien maire
de Roncq.
Près de la porte, rue du Bois Blanc, on peut voir les tombes de
trois
militaires anglais tués en mai 1940 rue Pasteur.
En face de l'entrée du cimetière, rue de Lille, il y avait un marchand
de
vélos , Désiré Cospain. C'était aussi un café,
siège « Des Joyeux
Pédaleurs ».
On arrive ensuite au complexe sportif Joël Bats, bâti à l'emplacement
de la
ferme Grimonpont.
Continuons à descendre vers l'église, au 114 se trouve l'école Saint-Roch
(mixte maintenant, c'était autrefois l'école
des filles, celle
des garçons se trouvait de l'autre côté).
Tout de suite après,
le contour de l'église avec, au bout à droite,
le presbytère . C'est là que le 15 septembre 1911 il faillit
y avoir un drame.
Le « Journal de Roubaix » raconte les faits en ces termes dans la
parution
du lendemain :
« Tentative d'assassinat sur la personne de Matthieu Boulanger,
curé à
Saint-Roch au Blanc Four. Les malfaiteurs sont entrés par effraction.
Ils
ont d'abord attaqué la bonne, Flore Bochard, qui dormait en bas,
avec une
matraque et deux revolvers, et l'ont emmenée dans le bureau du curé.
Ils
ont fait sauter le secrétaire et réclamé les clés du coffre fort.
N'ayant
rien trouvé, ils ont forcé la bonne à appeler M. le Curé qui était
à
l'étage. »
Comme ils menaçaient le curé, celui-ci les mit en confiance en leur
disant
qu'il allait leur donner l'argent qu'il avait. Alors, d'un mouvement
brusque, M. Boulanger relève le premier revolver de la main droite
et
abaisse l'autre d'un coup de poing. Les deux coups partent en même
temps
d'un l'atteint, au bras, l'autre à la tête. Les agresseurs prennent
la
fuite.
« Les voisins accourent, ayant entendu les coups de feu. Ils appellent
le docteur et la police. La bonne a tellement été effrayée qu'elle
a une
crise cardiaque. »
Nous l'allons pas reprendre ici l'histoire de l'église du Blanc
Four, elle
parue dans l'édition de Nord Eclair du 20 février 2000.
C'est au nº 101 que Honoré Cosyn fonda une saboterie .
Il était
né le 1er février 1865 à Lovendeghen près de Gand en Belgique,
comme beaucoup de nos ancêtres, et son épouse Rosalie Verhulst à
Halluin,
le 10 décembre 1867.
Ce n'était pas une mauvaise idée de fabriquer des sabots, car beaucoup
de
Roncquois en portaient pour aller au jardin, à l'école, au travail.
L'hiver
on y mettait de la paille pour avoir plus chaud. Pour les gros travaux
ils
étaient simplement en bois brut, mais les femmes coquettes aimaient
avoir
pour le dimanche de beaux sabots décorés et vernis.
Honoré et Rosalie eurent 10 enfants. 6 garçons et 4 filles qui ont
tous de
près ou de loin participé au succès de l'entreprise.
Avec l'arrivée des chaussures en cuir et en synthétique, le port
des sabots
a disparu. La grande entreprise, toujours au Blanc Four, au même
endroit! a diversifié ses activités autour du bois.
Le nº 12 a vu souvent ses activités changer.
Ce fut d'abord un
tissage puis, vers 1900, une minoterie exploitée par Mme veuve
Aloïs Ghesquière ; vint ensuite M. Titecat, marchand de charbon
et pommes
de terre et enfin M. Caboor, même profession.
Dans un petit journal « Le Dimanche de Roubaix-Tourcoing », daté
du 7 août
1932, à la page 8, on peut lire une enquête sur une biscuiterie
roncquoise
située au 113, rue de Lille (173 actuel). C'est, vous l'avez
deviné, la Biscuiterie Loridan. Dans cet article, l'auteur vente
la qualité
des produits et parle des 60 variétés de biscuits fabriqués ; des
secs, des
fourrés, des cakes, des gaufres et surtout des madeleines. Les frères
A. et
P. Loridan étaient déjà là en 1919. La biscuiterie occupait alors
100
mètres carrés. En 1932, il y en a 700. Là aussi les activités se
sont
diversifiées et les fameuses madeleines roncquoises sont fabriquées
à Caen
aujourd'hui.
Heureusement, il reste le cortège traditionnel.
Quelques mètres plus loin, à l'emplacement de la supérette, il y
avait une
fabrique de moutarde et vinaigre . On ignore
le nom du fabricant
ainsi que l'époque où elle a fonctionné. Les documents anciens sont
quelquefois très imprécis.
Après quelques maisons et la maréchalerie Capelle nous voici
arrivés au « Café Couronnée » (prénom féminin
au début du
20ème siècle). En 1922, la façade fut défoncée
par le tramway qui
avait son terminus rue de Tourcoing et qui, rompant ses freins,
traversa la
rue de Lille et alla s'encastrer dans l'estaminet (nous en reparlerons
plus
longuement quand nous arriverons à la rue de Tourcoing).
Toujours à gauche, il y avait une boulangerie aujourd'hui
démolie pour plus de visibilité au carrefour. C'est là que, le 12
avril
1905, éclata un violent incendie à 2 h du matin, que le « Journal
de
Roubaix » relate en ces termes :
« Incendie à la boulangerie Vandeputte au Blanc Four, dans les
bâtiments affectés à la boulangerie, écurie, remise en hangar. La
toiture
s'est effondrée, tout est détruit.» Un cheval qui n'avait pû s'enfuir fut carbonisé dans son écurie.» Les pompiers de Roncq ont mis deux heures pour éteindre l'incendie.
» Le cheval était déjà tombé, asphyxié par l'épaisse fumée.
» Les dégâts se montent à 5.000 F pour les bâtiments, 1.000 F
pour le cheval, 1.000 F pour les ustensiles de boulangerie,
500 F
pour le pétrin mécanique, 700 F pour le fourrage et la
farine,
300 F d'objets divers, soit 8.500 F.
» On suppose que le feu a pris à l'écurie qui est contiguë au four
en
briques de la boulangerie. Une étincelle sera passée par une fissure
du mur
et communiqué le feu à la paille. »
Au carrefour des rues de Lille et de Tourcoing eut lieu la phase
finale de
la bataille de Tourcoing en 1794. (Voir Nord Eclair du 2 mars 1997,
hameau
du Blanc Four I).
A droite, juste à l'emplacement de « Auto décor » <..>(21)<¥>,
existait un
charron. Sur son trottoir, stationnaient des chariots de fermes
de tous
calibres. Appuyées contre le mur, de grandes roues de bois qui attendaient
d'être réparées. Jules Devos était aussi maréchal ferrant. Il avait
deux
ouvriers, qui n'avaient pas jugé bon de faire grève en 1921. Revenant
en
cortège de l'usine des eaux rue Pasteur, les grévistes, voyant que
l'on
travaillait chez Jules, défoncèrent la porte et firent sortir les
ouvriers.
La maison de Jules Devos était très vieille, elle était déjà sur
le plan de
1830. Elle fut démolie en 1962 pour être remplacée par une maison
neuve et
un garage (le 194 actuel).
On nous a raconté qu'entre le Blanc Four et la Déviation, dans une
maison
en démolition on avait retrouvé une statue de Christ en bois de
hauteur
d'homme derrière un mur de la cave. Il est fort probable que ce
soit là,
car il n'y avait pas de maison aussi vieille dans le coin.
Cette statue daterait paraît-il de la Révolution. Elle était bien
humide et
abîmée. Qu'est-elle devenue&fine;? Si quelqu'un pouvait éclairer
notre
lanterne, il serait le bienvenu.
Juste à côté fut fondé par Marcel Cozette en 1908, une poterie
tuilerie et fabrique de tuyaux en terre vernissée, reprise par Scalabre
en
1920.
Après la ferme Catteau , toujours du même
côté, à une centaine
de mètres plus loin on voit une prairie un peu plus haute que la
route et
en pente. Sous cette herbe verte, il y a trois casemate allemandes
«blockhaus » de la guerre 1914-1918 <..>(24)<¥>. Comme
ces constructions
sont très difficiles à détruire, on a trouvé plus judicieux de les
recouvrir de terre et d'y semer de l'herbe afin de refaire une pâture.
Les
habitants de la rangée de la Déviation les dégagèrent en 1939 pour
servir
d'abri éventuellement. Les vieux Roncquois se souviennent qu'il
y avait
aussi à cet emplacement une vieille maison
disparue après 1945
qui était citée sur le cadastre comme bâtiment rural en 1830 et
ferme en
1912. Près de là aboutissait un sentier venant de la rue du Moulin,
près de
l'estaminet « Au Tonkin ». N'oublions pas que Roncq n'est pas un
« plat
pays » mais fait d'élévations et dénivellations très accentuées
par
endroit. Nos rues le prouvent. Nous sommes donc au lieu-dit « La
Déviation
» qui doit son nom au fait qu'en 1924, lors de l'installation
de la ligne de tramway R, celle-ci fut déviée dans les champs. Elle
passait
le long du « Bois Leurent » enjambant ensuite les rails du chemin
de fer
par une passerelle, pour rejoindre la rue de Lille par la rue du
8-Mai-1945
(rue du Gaz). Car la société de chemin de fer ne voulait pas que
les rails
du tramway croisent ceux du train. Le lieu-dit « La Déviation »
ne s'est
pas toujours appelé ainsi. Sur une carte de 1769 l'ingénieur géographe
du
Roi, R. Villaret dénomme cet endroit « Le pont à plume » (au singulier).
Une carte d'état-major de la fin du 18ème siècle
donne la même
appellation, mais au pluriel. Qu'était-ce ce pont à Plumes;?
Plus proche de nous, vers 1910, l'endroit est appelé « Le Boulevard
» car
la chaussée avait été refaite en pavés plats au lieu de gros grés
ronds. Un
café changea de nom et devint « Le Boulevard »
Le 27 mars 1906, le Journal de Roubaix raconte : « Henri Dekeyser,
27
ans, berger chez Vanluchène faisait paître ses moutons au lieu-dit
« Le
Boulevard » le long de la route nationale 17, quand une automobile
roulant
à vive allure, a accroché le chien du berger et l'a tué sur le coup,
a
poursuivi la route sans s'arrêter.
» Le chauffeur était revêtu d'un manteau de peau à long poils noirs,
coiffé d'une casquette nouée à visière luisante. »
Imaginez à notre époque un troupeau de moutons en train de paître
le long
de la rue de Lille&fine;!
Quelques années plus tard, en janvier 1909, un jeune homme de 22
ans,
jabitant rue de Tourcoing, revenait chez lui vers onze heures du
soir,
après s'être un peu amusé dans un café au centre. Arrivé au lieu-dit
« Le
Boulevard » il entendit des plaintes et s'étant approché, il trouva
un
homme couché par terre qui lui dit avoir été écrasé par une voiture
à deux
roues qui était partie vers le Blanc Four, l'homme avait 59 ans
habitant
Tourcoing. Comme il était blessé le jeune homme courut chercher
le docteur Galissot, tandis que des voisins installait le blessé dans la salle
de
l'estaminet « Le Boulevard ».
Le docteur constata qu'il avait la cuisse cassée et le fit admettre
à
l'hôpital.
Mais, après enquête, il s'avéra que le blessé était un ivrogne qui
avait
été vu en état d'ébriété dans la soirée, et tout porte à croire
qu'il n'a
pas été écrasé car ses vêtements ne portent pas de traces de roues.
Son
pantalon déchiré aux genoux prouve qu'il est tombé plusieurs fois,
et c'est
probablement dans sa dernière chute qu'il s'est cassé la cuisse.
C'est
aussi l'avis du docteur Galissot.
A droite de la route, il y avait la ferme Castelle
qui portait
la date de 1876 sur le pignon. A cet emplacement s'élèvera bientôt
un parc
de loisirs.
Du même côté une centaine de mètres plus loin, à l'emplacement actuel
de Chocmond, se trouvait l'usine Leurent , filature
de lin.
L'histoire a commencé quand André Leurent, venant de Dunkerque où
il était
né en 1774, s'installa à Roncq comme médecin avec son épouse Sophie
Suin de
Tourcoing. Ils eurent 10 enfants Eugénie, Jules, Laurence, Louise,
Henri,
Joséphine, Hermance, Victor (décédé à 1 an), Victor (décédé à 10
ans),
Désiré qui a épousé Pauline Lefort, dont il eut 6 enfants.
André était un homme paisible et bon, qui ne faisant pas fortune
car
beaucoup de Roncquois avaient recours aux rebouteux.
Afin de pouvoir élever ses enfants et leur payer des études, son
épouse
Sophie eut l'idée de créer un commerce de tissus au 411, rue de
Lille
(Macif). Quelques années plus tard leur fils Henri trouva qu'il
serait plus rentable de fabriquer du tissu plutôt que simplement le vendre.
Il détourna
de sa carrière de médecin son frère Jules. Le jeune Désiré les rejoindra
plus tard.
Ils rachètent alors un tissage à Tourcoing, mais les affaires ne
marchent
pas et c'est le désastre.
Pour redresser la situation, maman Sophie n'hésite pas. Elle engage
sa
fortune personnelle, les biens de son mari décédé et la dot de ses
filles
qui restèrent célibataires. Son but était de créer à Roncq, une
filature de lin, ce dernier étant beaucoup cultivé à Roncq et environs et même
roui sur
place aux lieu-dit « Riche Vinage » ou sur pré, ou champ.
Le 1er août 1879 une société fut fondée sous
la raison sociale de
Leurent Frères (Henri étant décédé) achètent à Roncq un terrain
dont une
parcelle appartient à Jean-Charles Desrumaux et le reste à Jean-Baptiste
Quecq de Lille. Le tout près de la gare. La première partie de l'usine
fut
bâtie à 50 mètres en retrait de la route, elle comprenait trois
étages. On
voulait que cette façade ait fière allure. Tout en haut, une petite
niche
abritait une statue de saint Joseph. La « Filature de la Vallée
» était
née.
Afin de faciliter l'entrée du lin dans l'usine, un raccordement
de 300
mètres avait été établi avec la voir de
chemin de fer toute
proche. Des trains entiers, lourdement chargés de lin, arrivaient
en gare.
Ils y laissaient les wagons destinés à l'usine. C'est un par un
que ces
derniers étaient acheminés dans l'entreprise, tirés par des chevaux
ou
poussés par des ouvriers et en dernier lieu tractés par un engin
motorisé.
Une bascule permettait d'en contrôler le poids.
En 1884 on y ajouta, écurie, remise, un tissage de lin, puis de
1887 à 1909
d'autres agrandissements. Tant et sin bien qu'en 1914, l'usine occupera
18.000 mètres carrés et comprendra, outre la filature, un peignage,
un
tissage, un magasin, une filature d'étoupe, une salle de préparation,
un
dévidage, une forge, un bassin de décantation, une plaque tournante
et la
voie ferrée, un pont à bascule, une génératrice, des bureaux, une
cheminée,
la maison du concierge, le réfectoire. Les machines, dont Désiré
était très
fier, venaient d'Irlande, de la compagnie « James Mackie et Sons
».
En 1896 les demoiselles Leurent, Eugénie et Hermane, cédèrent leurs
parts à
leur frère Désiré, Jules était décédé en 1883.
Désiré avait épousé Pauline Lefort dont il eut 6 enfants. L'aîné
Désiré
(qui épousera plus tard Berthe Hassebrouck) et Edouard avaient rejoint
la
société ainsi que Léon Vernier Leurent, gendre de Désiré père. La
société
devint alors Leurent et Compagnie.
En 1902 Désiré Leurent Lefort laisse la place à ses fils et gendre.
Mais
celui-ci quitte la société qui s'appelle désormais Leurent Frères.
Désiré père habitait une grande maison au centre de Roncq, qu'il
avait fait bâtir (nous y reviendrons). Quant à Désiré fils, il habitait Tourcoing
et
prenait chaque matin le train pour venir à l'usine. Pour se rapprocher
de
son travail, il acheta en 1903 à Henri, Valéry et Malvina Dupont,
filateurs
de lin à Halluin, une grande maison qu'il fit agrandir en 1920 (notre
mairie actuelle).
Pour faire marcher l'usine, la main d'ouvre ne manquait pas, il
y avait
bien sûr des Roncquois, Halluinois, Bousbecquois, Linsellois, mais
aussi
beaucoup de Belges. On en compte 406 en 1927. Vers 1950, les ouvriers
et
ouvrières venaient plutôt de la région minière. Des autocars complets
venant de Seclin, Hénin Liétard (Hénin Beaumont aujourd'hui), Lens,
Courcelles, Montigny-en-Gohelle, etc., les amenaient pour les équipes
de 5
h à 13 h et de 13 h à 21 h.
La guerre de 1914-1918 stoppe totalement l'activité de l'usine.
C'est
d'abord l'occupation, puis les réquisitions des métaux, des machines,
au
grand désespoir du patron. Les salles et locaux servent de cantonnement
ou
magasins pour l'armée.
Quand la guerre finira il ne restera que des salles vides. Le 14
octobre
1918, quand les Allemands se retirent, ils ne veulent rien laisser
derrière
eux et dynamitent la salle des machines, comme ailleurs, pour ruiner
notre
industrie.
Après la guerre, les dégâts furent réparés grâce aux dommages de
guerre.
Désiré acheta de nouvelles machines en Irlande et l'activité reprit.
En 1939 l'usine n'eut pas tant à souffrir. Elle tourna cependant
au
ralenti. Beaucoup d'hommes étaient prisonniers ; la matière première,
le
lin, était encore disponible dans la région et ailleurs en France.
La pleine activité reprit vers 1945 et la filature atteignit son
apogée
dans les années 1950-60.
Avec l'arrivée sur le marché des matières synthétiques, les affaires
déclinèrent et, en 1986, l'usine, qui avait été rachetée entre-temps
par le
groupe Boussac Saint Frères, ferma ses portes. Une partie du personnel
partit travailler à Neuville-en-Ferrain sur la zone industrielle
où une
entreprise de moindre importance « La Française du Lin » avait été
installée.
Les bâtiments de la « Filature de la Vallée » restaient inoccupés.
Quelques
années plus tard il fut décidé de les démolir.
Le mardi 14 avril 1992, 28.000 mètres carrés du site étaient réduits
en
gravats. Il ne restait que le bâtiment en front-à-rue et la cheminée
qui se
dressait au milieu de la cour.
Le 8 avril, comme si elle disait un dernier adieu, les Roncquois
purent la
voir cracher des volutes de fumée noire et le 14 avril, à 11 h 45,
elle
implosait.
Un souvenit cher au cour de vieux Roncquois et Roncquoises, c'est
le bassin
du « réfrigérant » au milieu de la cour, ou l'été, ils pouvaient
faire
quelques brases dans une eau tiède, lorsque la filature était en
activité.
C'est en décembre 1996 que fut posée sur ce site la première pierre
de
Chocmod.
De l'autre côté de la rue de Lille où se trouve aujourd'hui Actival
, était une autre usine : « Chez Motte »,
« à m'mou Motte »
comme on disait autrefois. Cette manufacture de draperies fut construite
par les frères Leurent, filateurs de lin. Ceux-ci possédaient déjà
5
hectares, 11 ares de terres de labours achetées vers 1890. Ils achetèrent
en 1907 1 hectare 25 ares de plus à quelques cultivateurs roncquois,
Couvreur, Catteau, Destombes, Leconte et à un certain M. de la Chaussée,
demeurant à Paris, afin d'y faire construire l'usine.
En 1908 la municipalité voulait élargir le chemin latéral au
chemin de fer et proposa alors aux frères Leurent de leur acheter
7 ares 58
dans ce but. Après quelques discussions sur le prix, les frères
Leurent
cédèrent le terrain pour le franc symbolique.
L'usine avait à peine produit pendant quelques années, que la guerre
de
1914 survint. Comme la filature de lin, l'usine fut occupée par
les
Allemands, les métaux, les métiers furent réquisitionnés. Des bains-douches
pour l'armée y fonctionnèrent, chauffés par les chaudières. Le 14
octobre
1918 au matin, les Allemands firent sauter la machine à vapeur et
les
générateurs de courant.
ZE 1920, les frères Leurent vendirent la manufacture à la société
anonyme
Motte-Dewavrin dont le président était M. Alphonse Motte-Dhalluin,
elle
devint alors la « Manufacture des Draperies de Roncq » dont le P.-D.G.
était Pierre Motte. Les frères Leurent cédèrent en même temps les
dommages
de guerre pour reconstruire l'usine.
L'usine se développa et s'agrandit. Outre le tissage, les magasins
les
bureaux, la génératrice, l'écurie, la cheminée, etc., on y ajouta
une salle
de préparation, une de retordage en 1928, et un atelier de piqûrage
en
1932. La laine entrait en gros ballot par une porte de la rue Latérale
après avoir été piqûré, le tissu partait vers Tourcoing pour y être
lavé et
teint. L'usine occupait moins de Belges que la filature de lin.
C'était
surtout du personnel roncquois. Ce personnel était souvent plus
fier. Pour
certains ateliers, les femmes allaient travailler en chapeau.
Une partie de la production était destinée à l'armée et les ouvrières
du
piqûrage voyaient défiler entre leurs mains de grandes pièces de
tissu
kaki. Une autre partie était destinée à l'Angleterre.
Au milieu de la cour il y avait un grand bassin de décantation qui
recevait
les eaux du lavage de la laine brute. Par temps de chaleur, ce bassin
dégageait une odeur telle, qu'il fallait fermer les fenêtres. L'usine
Motte
était une des rares entreprises où la laine entrée en toison ressortait
en
tissu. Il ne manquait que la teinture qui était effectuée chez Motte
Dewavrin rue des Anges à Tourcoing.
Tout comme la filature de lin, l'activité déclina avec l'arrivée
sur le
marché des fibres synthétiques et, le 12 décembre 1982, Motte Dewavrin
déposa son bilan.
Dans les locaux vides s'installerent plusieurs entreprises et le
site fut
appelé « ACTIVAL ».
|
Jacqueline et Julien avec l'aimable autorisation de Nord
Eclair moyens techniques CRRAI http://www.crrai.com tél:03.20.94.12.32 |